Les termes « musique arabe » peuvent prêter à certaines équivoques : ils sont justifiés si l’on désigne par là l’expression historique d’une civilisation dont la langue arabe et la culture islamique constituent les deux axes fondamentaux (mais ils sont impropres si l’on entend par « musique arabe » les formes d’un art inhérent aux Arabes et au monde Arabe définis ethniquement et géographiquement). Cet art couvre en fait des réalités esthétiques et ethnomusicologiques variées et parfois fort éloignées, mais marquées du sceau unificateur de l’islam et de ses conquêtes à partir du monde arabe. De plus, il existe au sein même des pays arabes des musiques non arabes issues de communautés ou d’ethnies diverses (kurde, berbère…).
Prenant sa source dans l’Arabie préislamique, berceau de plusieurs innovations musicales, la musique arabe s’est progressivement répandue hors des frontières de l’Arabie, à la suite des conquêtes arabes et du mécénat des califes, sur un vaste territoire s’étendant de la péninsule ibérique au sous-continent indien, voire l’Indonésie. Elle est un genre musical commun à 22 pays qui se décline en différentes variétés régionales.
Epoque contemporaine
Avec la montée de l’Empire Ottoman et la conquête du Sultanat Mamelouk, la musique ottomane, déjà influencée par les musiques byzantine, arménienne et persane, s’enrichit d’une influence arabe. À la fin de l’Empire ottoman, la musique arabe proprement dite, connait une renaissance au XXe siècle, sous les effets conjugués de la politique (nationalisme), de certaines techniques musicales et l’introduction d’instruments occidentaux, et de la volonté grandissante de sauvegarder le patrimoine musical arabe.
L’Égypte notamment vit l’éclosion d’immenses talents, compositeurs ou chanteurs, comme Mohammed Abdel Wahab, la chanteuse Asmahan ou encore Oum Kalthoum, qui emprunte d’ailleurs son nom à la poésie arabe préislamique et dont la carrière avait commencé dès 1932. À la fin des années 1960, elle élabore un nouveau style qui trouve aussi ses aficionados.
De nombreuses femmes comme Oum Kalthoum marquent en effet la musique arabe tout au long du XXe siècle, notamment depuis Le Caire, foyer du féminisme dans la région. Mounira El-Mahdeya est la première musulmane à monter sur scène, d’abord déguisée en homme, enregistrant de la musique dès 1906.
Dans l’entre-deux-guerres, la productrice Badia Masabni ouvre des cabarets et perfectionne la danse orientale telle qu’elle existe encore de nos jours. Dans la seconde partie du siècle, l’Algérienne Warda al-Jazairia et la Libanaise Faïrouz sont des personnalités majeures de la musique arabe. En 2021, l’Institut du monde arabe à Paris consacre une exposition à toutes ces femmes.
La pop arabe est principalement produite et originaire du Caire, en Égypte ; avec Beyrouth, au Liban comme centre secondaire. C’est une excroissance de l’industrie cinématographique arabe (principalement des films égyptiens), également située principalement au Caire. Le style principal est un genre qui combine synthétiquement des mélodies pop avec des éléments de différents styles régionaux arabes, appelés ughniyah (arabe) ou en français 3chanson arabe3. Il utilise des instruments à cordes, y compris la guitare, ainsi que des instruments traditionnels du Moyen-Orient.
Un autre aspect de la pop arabe est le ton général et l’humeur des chansons. La majorité des chansons sont dans une clé mineure, et les thèmes ont tendance à se concentrer sur la nostalgie, la mélancolie, les conflits et les questions d’amour en général.
Rock agérien
Le rock algérien, initié la fin des années 1960 et début 70 par divers groupes comme T34, Abranis ou Les Berbères, est popularisé sur la scène internationale dans les années 1980–1990 par Rachid Taha, leader du groupe lyonnais Carte de séjour comprenant à l’époque Mokhtar Amini, Jérôme Savy, Mohamed Amini, Djamel Dif, Éric Vaquer, Brahim M’Sahel et Abdelhak Jallane. Au départ de plusieurs membres, Carte de séjour se retrouve avec Rachid Taha (voix), Mokhtar Amini (basse), Jérôme Savy (guitare) et Mohamed Amini (guitare rythmique).
Instruments traditionnels
Les instruments les plus usités dans la musique arabe sont l’oud, ancêtre du luth européen employé parfois comme basse mélodique ou rythmique dans les ensembles instrumentaux, et le nay, une flûte de roseau. Les instruments à percussion les plus courants sont des tambours en forme de vase (comme la darbouka) et des tambourins avec ou sans sonnailles (daf, riqq ou tar). Les noms et les formes des instruments varient en fonction de leur région d’origine.
Le rabâb arabe, vièle jouée verticalement, côtoie le violon, notamment dans les orchestres arabo-andalous. Parmi les autres instruments classiques figure le qanûn (qanoun) – adopté dans l’Europe médiévale sous le nom de psaltérion, cithare à soixante-douze cordes métalliques.
*Source : wikipedia
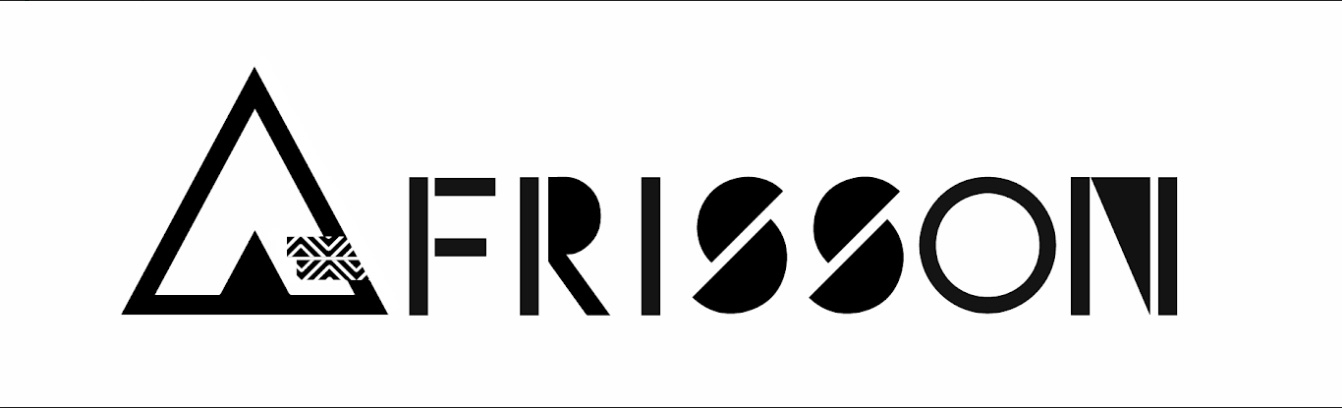
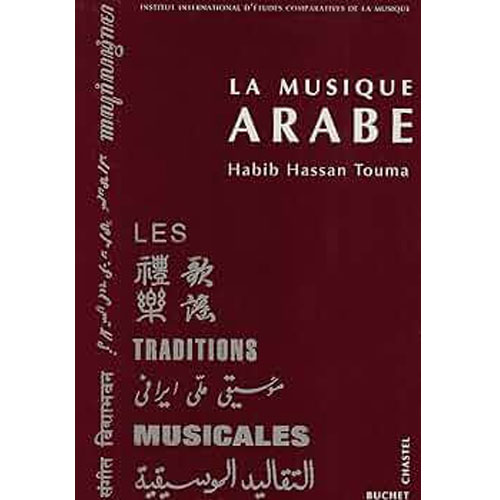



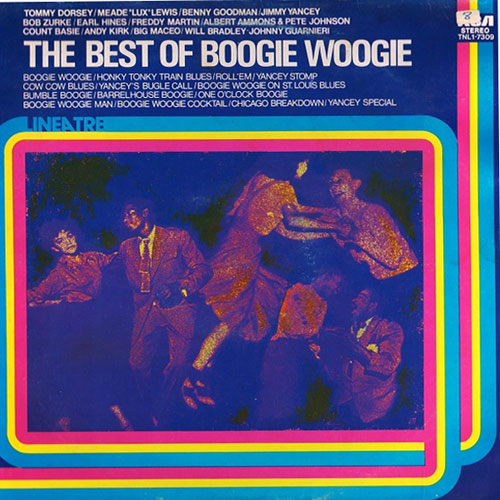
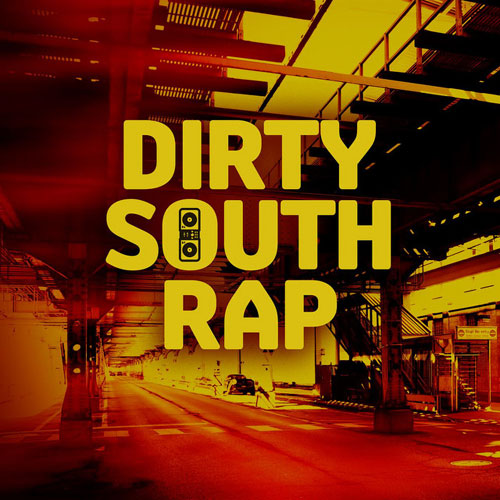
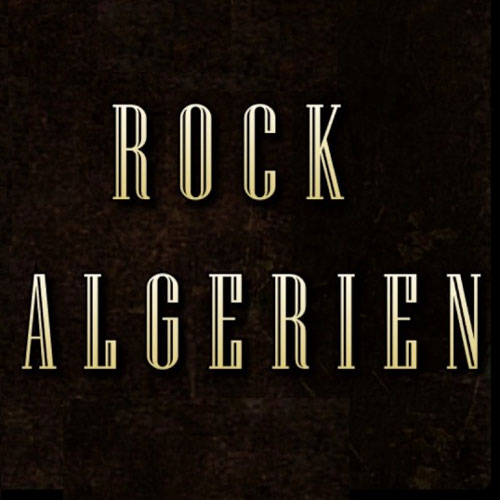
Laissez un commentaire
Vous devez être logged in pour poster un commentaire.