Le tsapiky emprunte clairement sa construction à la musique régionale de Tuléar jouée avec le kabosy (petite guitare à 4 ou 6 cordes), le marovany (cithare sur caisse), l’accordéon, à la mandaliny (guitare à trois cordes), au lokanga (violon) et au jejolava (arc musical)… Le déroulement d’un morceau suit un schéma incontournable qui pousse à la transe ; tout l’art consiste en une sorte de dialogue mimétique entre danseurs et musiciens, et l’énergie du tsapiky tient dans cet échange d images mélodiques, rythmiques et gestuelles. »Kitariky » : exposition du chant (c est en général la première partie) »Kilatsaky » : le rythme s’accélère et incite à la danse. »Kifolaky » : »Rupture » dans le kilatsaky, censée le relancer de plus belle.
De nombreux artistes contemporains dont Damily, Tao Ravao, Solorazaf et Roby Chicungunya l’ont adapté ou intégré à une orchestration moderne, avec guitare électrique, basse, batterie, claviers, congas, y greffant de la pop, de l’afro-jazz, de l’afro zouk, du rock, du reggae ou encore du rap…
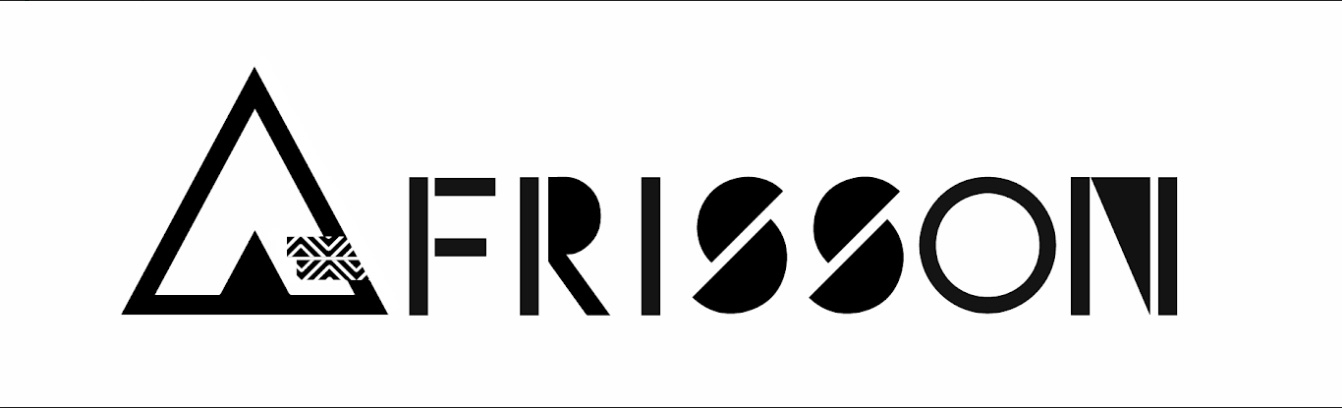


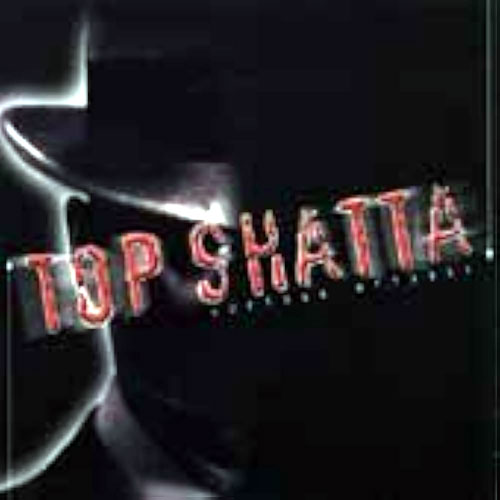

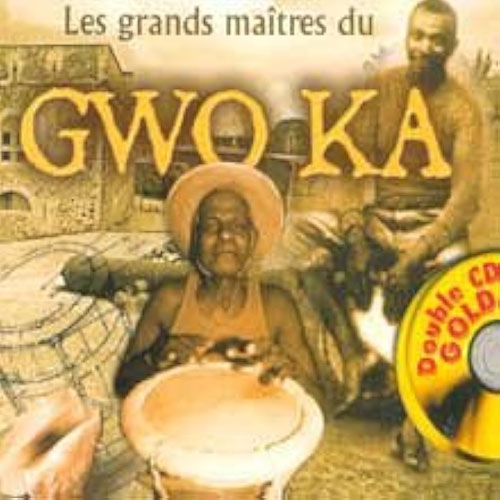

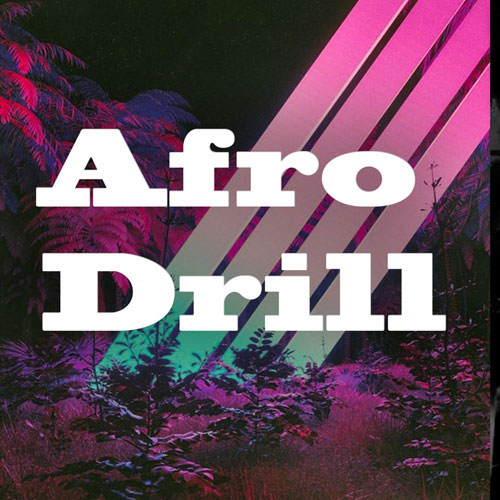
Laissez un commentaire
Vous devez être logged in pour poster un commentaire.