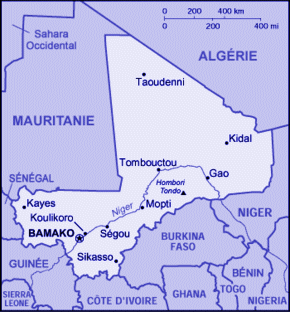
Suivant l’expérience guinéenne de modernisation de la musique mandingue, le Mali qui veut dire « hippopotame » et qui a des racines culturelles communes avec la Guinée encourage l’orchestration des rythmes régionaux dès l’indépendance en 1960.
Les années 1960 : le Mali multistyles
Dès cette date, des artistes se distinguent comme Kélétigui Diabaté, le virtuose du balafon, Boubacar Traoré aka Kar Kar, adepte de musique khassonkée, le groupe Super Biton aux rythmiques bambara ou Sorry Bamba, modernisateur de la musique dogon. A la même période, le guitariste Ali Farka Touré puise dans les racines songhaï et touareg son blues mandingue aux sons sahéliens. Cette décennie marquée par le marxisme-léninisme prôné par le président Modibo Keïta voit une floraison de groupes et de troupes de ballets dont le Ballet National qui accueille en son sein, en 1963, le percussionniste-danseur Zani Diabaté de Djata Band, promoteur au sein de plusieurs groupes d’un style aux confluents de la musique mandingue du blues et du funk.
Les années 1970 : le Rail Band et le Badéma National
En 1970 naît le Rail Band du saxophoniste Tidjane Traoré, une formation pionnière révélatrice de nombreux talents du pays et de la région dont Salif Keïta, l’une des plus belles voix du continent. Son célèbre titre « Mandjou » interprété en malinké donne à la musique malienne ses lettres de noblesse. Autre figure de la scène nationale, le groupe Las Maravillas de Mali créé en 1965 à la Havane (Cuba) par des étudiants maliens dont le flûtiste Boncana Maïga opte pour un afro-cubain et une rumba à la sauce mandingue. Rebaptisée Badéma National (un des orchestres officiels du pays), la formation s’oriente vers le style moderne mandingue suivie des Ambassadeurs du Motel de Bamako, du Manding Jazz et des Les Ambassadeurs Internationaux.
Les griots prennent la voie de la modernité
En 1972, Kassé Mady Diabaté, un griot rompu à la tradition musicale est désigné par le gouvernement malien pour être l’interprète du Badéma National, établissant le lien entre deux mondes musicaux. Une nouvelle vague d’artistes dont des griots et griottes adeptes du registre moderne explorent de nouveaux sons. L’un des plus prolifiques de cette génération, Toumani Diabaté, issu d’une lignée de joueurs de kora (il est le fils du fameux korafola Sidiki Diabaté), s’est avant tout préoccupé d’universaliser cet instrument sans trahir la tradition. S’imposent également Kandia Kouyaté, Amy Koïta, Nahawa Doumbia et Oumou Sangaré, des divas du style wassoulou. La chanteuse Bassey Koné diffuse le style malinké tandis que Diaba Koïta développe le beat khassonké, une sonorité mandingue popularisée par Boubacar Traoré . L’extraordinaire Mangala Camara, à la voix tellement riche d’intonations apporte une autre couleur à la musique mandingue.
Les instrumentistes du mandingue
S’imposeront aussi toute une série d’instrumentistes. Cheikh Tidiane Seck, arrangeur et claviériste hors pair, se glisse dans le monde du jazz (on peut citer sa rencontre avec Hank Jones), les guitaristes Moussa Diabaté qui a posé ses notes sur les musiques de divers artistes ou Djelimady Tounkara qui a lancé un style néo-mandingue et un jeu de guitare inspiré des joueurs de « tres cubain ». Habib Koité mêle rythmes malinké, bôbô, songhaï et peul, le guitariste Lobi Traoré diffuse un blues aux accents bambara de Ségou et Rokia Traoré adopte un folk new look. Un des plus grands saxophonistes du mandingue, le vieux Tidiani Koné enregistrera un album de ses meilleurs succès quelques mois avant de disparaître.
Années 2000 : l’avènement de la musique touareg.
Honorée de nombreuses récompenses dont plusieurs Grammy Awards (Oumou Sangaré, Ali Farka Touré, Toumani Diabaté), la musique malienne se fait une place remarquée sur la scène internationale. Les années 2000 voient la percée de la musique touareg avec des groupes comme Tinariwen signé par Universal et nominé aux Grammy Awards en 2012.
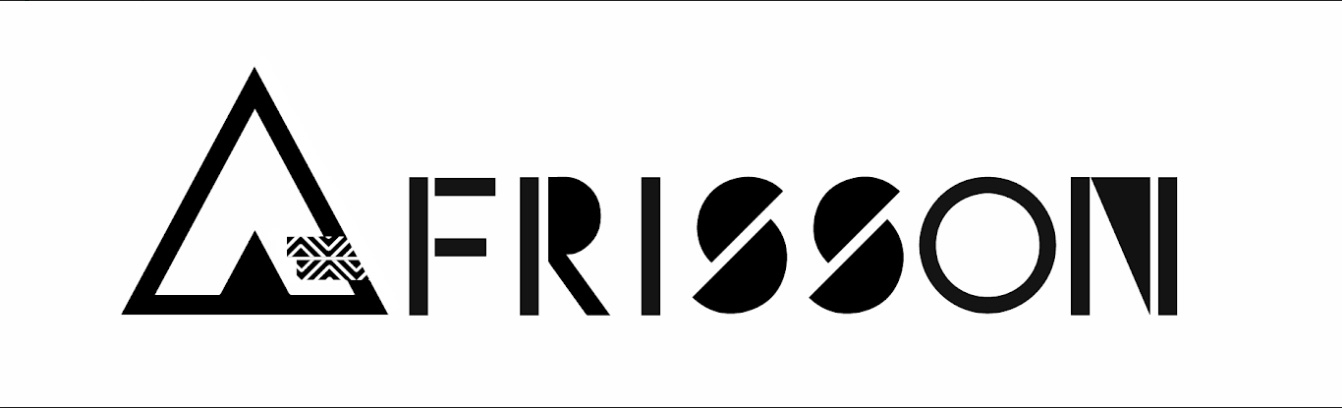





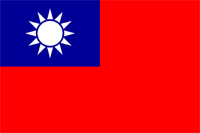
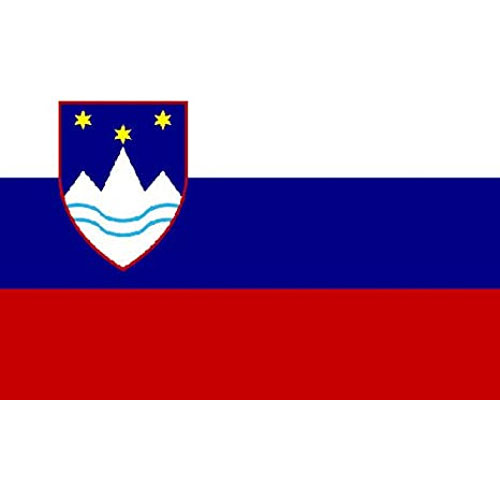

[…] Mali […]
[…] Mali […]
[…] Mali […]
[…] Mali […]
[…] Mali […]
[…] Mali […]
[…] Mali […]